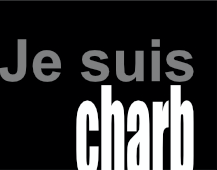Deux jours passés au milieu d’un vignoble du Pic-St-Loup au domaine de Lancyre pour présenter l’activité charbonnière de nos garrigues. Un pur plaisir à la fois par le site, les rencontres et l’exceptionnelle qualité de l’équipe du Château de Lancyre. Christel et Régis Valentin, les heureux propriétaires de ce vignoble, nous ont accueilli avec une bienveillance remarquable. Lancyre en liberté est un parcours de 4,5 km dans ce vignoble qui pour ces deux journées était émaillé de stands de dégustation des vins du château ainsi que des animations patrimoines et produits du terroir.

Perché au sommet de ma colline j’ai rencontré quelque trois cents personnes dans l’emplacement d’une ancienne charbonnière. Encore une fois pour beaucoup c’était une découverte de ce métier et de la carbonisation.


Un atelier d’art pariétal et faute de grotte de beaux cailloux du Crétacé ont fait l’affaire. Pas mal de visiteurs, enfants et adultes, ont crayonné au fusain comme quoi nos ancêtres préhistoriques ont encore de l’influence sur nos comportements.

A coté il y avait Floriane et Gabriel, les tenanciers sympathiques du stand, qui proposaient la dégustation de deux vins, un blanc D’ombre et lumière et un rouge Madame, deux vins superbes.

Une belle manifestation qui montre combien le vignoble et la garrigue sont intimement liés dans notre environnement. Une sorte de retour aux sources pour moi avec le souvenir de notre grande manifestation à Sainte-Croix, Lo Gabel (Taille de la vigne et patrimoine vernaculaire), il y a 25 ans, où j’ai rencontré Louis qui m’avait initié aux savoir faire des charbonniers.
Merci à toutes et tous, celles et ceux du Château de Lancyre, les nombreux bénévoles qui ont participé et un spécial merci à Chloé pour son interface amicale.




























































































































 La semaine est passée et après 6 jours de cuisson j’ai arrêté la charbonnière. Nous devons attendre 2 à 3 jours avant le cavage, le défournage.
La semaine est passée et après 6 jours de cuisson j’ai arrêté la charbonnière. Nous devons attendre 2 à 3 jours avant le cavage, le défournage.










 Malgré le froid piquant, j’ai repris les cuissons. Avant cela j’ai modifié les tuyaux des gaz des tonneaux. Des tubes de 18 et 20 mm, car avec les anciens moins gros ils avaient tendance a se boucher avec la suie. J’ai positionné un bouchon sur chacun qui laisse une ouverture possible pour ramoner.
Malgré le froid piquant, j’ai repris les cuissons. Avant cela j’ai modifié les tuyaux des gaz des tonneaux. Des tubes de 18 et 20 mm, car avec les anciens moins gros ils avaient tendance a se boucher avec la suie. J’ai positionné un bouchon sur chacun qui laisse une ouverture possible pour ramoner.