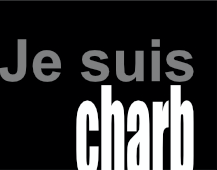L’EKV, association européenne des charbonniers, a publié un livret sur les charbonnières en fosse. Nous sommes quatre rédacteurs a y avoir contribué.
« A propos de la carbonisation du bois dans les fosses« .

Les différents articles sont pratiquement tous relatant des expériences, dans des fosses plutôt classiques en rond. Et souvent associé à des archéologues. Ce qui fut mon cas en Hollande, avec une équipe de chercheuses (https://www.altimara.eu/blog/2021/11/04/archeo-et-fosse/).

Dans mon article, en français et en allemand, je parle de mes différentes cuissons en fosse. Une des plus vieilles technique de carbonisation que l’homme avait mis au point pour la production de charbon de bois en quantité. C’est tout au moins ma conviction.

Je remercie l’EKV, de m’avoir sollicité pour cette publication, ainsi que Charles Schlosser pour la traduction en allemand.
Possibilité de commander ce livret :
„Über die Verkohlung des Holzes in Gruben“
Wenn wir uns mit diesem Heft daran machen, praktische Verfahren der Verkohlung von Holz in Grubenmeilern experimentell zu beschreiben, begeben wir uns auf nahezu unbekanntes Land, denn die Technik der Grubenköhlerei ist schon lange aus der Übung gekommen. Und so verstehen sich auch die Beiträge dieses Heftes als Versuche mit offenem Ausgang, der Praxis der Grubenköhlerei auf die Spur zu kommen.
Vorgestellt werden drei Versuche mit unterschiedlichen Varianten:
– Thomas Faißt, Baiersbronn, beschreibt das Grubenmeiler-Experiment im Campus Galli;
– Josef Gilch, Ebermannsdorf, stellt eine experimentelle Betrachtung über zwei Grubenmeiler in Ebermannsdorf vor;
– Martial Acquarone, Ste Croix De Quintillargues (Frankreich) resümiert seine mehrjährigen Erfahrungen mit unterschiedlichen Varianten von Grubenmeilern.
Abgerundet werden dieses Praxisberichte durch eine Zusammenstellung von wichtigen Quellen der Grubenköhlerei in alten Fachbüchern zur Köhlerei.
Ich bin froh und dankbar über die Bereitschaft der drei Autoren, ihre Erfahrungen auf der Suche nach einer vergessenen (vielleicht sogar verlorenen) Technik der Köhlerei zur Verfügung und sich einer hoffentlich einsetzenden Fachdiskussion unter Expertinnen und Experten der aktuellen europäischen Köhlereiszene zu stellen. Einen grossen Köhlerdank für eure historische Neugier und das erkennbar gute Knowhow!!!
Das Heft kann beim Europatreffen in Erlinsbach direkt erworben oder bei mir bestellt werden (tielke-borchen@t-online.de). Der Preis beträgt 9,00 € zzgl. Versandkosten.
En Français (…approximatif) :
« Sur la carbonisation du bois dans les fosses »
Lorsque nous entreprenons dans ce livret une description expérimentale des méthodes pratiques de carbonisation du bois dans les fosses, nous entrons dans un territoire presque inconnu, car la technologie du charbon de bois est depuis longtemps hors d’usage. Les contributions à cette question sont donc considérées comme des tentatives illimitées pour aller au fond des pratiques de l’extraction du charbon.
Trois expériences avec différentes variantes sont présentées :
- Thomas Faißt, Baiersbronn, décrit l’expérience sur les pieux sur le campus de Galli ;
- Josef Gilch, Ebermannsdorf, présente une étude expérimentale de deux fosses à Ebermannsdorf ;
- Martial Acquarone, Ste Croix De Quintillargues (France) résume ses nombreuses années d’expérience avec différentes variantes de fosses.
Ce rapport pratique est complété par une compilation de sources importantes sur la fabrication du charbon de bois dans des ouvrages anciens spécialisés sur la fabrication du charbon de bois.
Je suis heureux et reconnaissant de la volonté des trois auteurs de partager leurs expériences dans la recherche d’une technique oubliée (peut-être même perdue) de fabrication du charbon de bois et de participer à ce qui sera, je l’espère, une discussion spécialisée entre experts de l’actuel charbon de bois européen.
Le magazine peut être acheté directement lors de la réunion européenne à Erlinsbach ou commandé chez moi (tielke-borchen@t-online.de). Le prix est de 9,00 € plus frais de port.