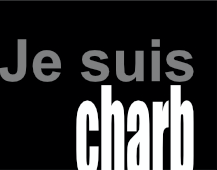Avec René, l’expert en technique du feu, nous avons accueilli un groupe de jeunes mal-entendants de Institut National des Jeunes Sourds à Bordeaux, dans l’écosite des charbonnières. La visite s’est déroulée avec pour communiquer la langue des signes. Certains jeunes, bien appareillés aux oreilles, pouvaient discuter normalement.
Avec René, l’expert en technique du feu, nous avons accueilli un groupe de jeunes mal-entendants de Institut National des Jeunes Sourds à Bordeaux, dans l’écosite des charbonnières. La visite s’est déroulée avec pour communiquer la langue des signes. Certains jeunes, bien appareillés aux oreilles, pouvaient discuter normalement.
Nous avons commencé par une approche générale du milieu garrigue. Plantes odorantes, piquantes et toxiques, ça a impressionné ces adolescents en demande de découverte nature. Nous avons pu échanger sur la compréhension des origines des garrigues et de l’impact de l’activité humaine sur cette végétation.

Après un assez long trajet au travers des sentiers du site, nous nous sommes installés autour de Blanchette, ma charbonnière que j’avais monté la veille mais qui n’était pas allumée. Un petit feu de bois a bien enfumé tous le monde car les bûches étaient bien humides, une sorte de rappel de ce qui allait se passer quand j’allumerai la meule.

Puis René a démarré son atelier feu. Le pouvoir de « faire du feu » avec des pierres, des réflecteurs ou de curieux petit objets, est toujours captivant. Les jeunes se sont éclatés. J’ai pris en alternance l’autre demi groupe autour de la meule sur l’aire de charbonnage. La technique de carbonisation et les conditions de vie des charbonniers, avec la cabane en fond de décors, ont surpris ces sympathiques jeunes ainsi que leurs accompagnants.



Certains ont dessiné avec des fusains et m’ont offert, en signe amical, deux de leurs œuvres.

Fin de visite, ils étaient joyeux, si même pour quelques uns ce fut plus difficile à cause de leurs autonomies. Nous avons été surpris par leur attention, leur « écoute », qui a été constante tout au long de la journée. Les échanges ont été finalement faciles. C’était pour la majorité d’entre eux une grande découverte d’un milieu inconnu. Cela a été pour nous la découverte d’un public particulier et attachant. J’aimerai continuer, et René est aussi dans la même disposition d’esprit, a accueillir des jeunes et moins jeunes mal-entendants. Et développer un protocole d’animation patrimoine de pleine nature pour cet handicap.
Merci à ces sympathiques jeunes et leurs encadrants.

Photos René et Martial